Regardez ce petit chef d’oeuvre de vulgarisation du darwinisme (en anglais sous titré)
Daniel Dennett commence sa présentation en présentant « l’étrange inversion de raisonnement de Darwin » à partir d’une citation d’un critique de l’époque :
“Dans la théorie qui nous est soumise, l’Ignorance Absolue est l’artificier; ainsi nous pouvons énoncer comme principe fondamental de tout le système que, pour faire une machine parfaite et magnifique, il n’est pas nécessaire de savoir comment la réaliser. On trouve dans cette proposition, après examen attentif, l’expression sous forme condensée de la Théorie qui exprime en peu de mots toute la pensée de Mr. Darwin; lequel, par une étrange inversion du raisonnement, semble penser que l’Ignorance Absolue est pleinement qualifiée pour prendre la place de la Sagesse Absolue dans toutes les réussites du talent de création.” (Robert Beverley MacKenzie, 1868, traduit par Dr. Goulu)
Dennett ponctue sa lecture animée de cette citation par deux profonds « Exactly! … Exactly! », et explique qu’effectivement la théorie de l’évolution résulte d’une inversion du raisonnement qu’il illustre avec 4 thèmes:
- Pourquoi aimons-nous le miel ? Pas parce qu’il a un goût sucré, mais parce que c’est un aliment à haute valeur énergétique et que l’évolution a développé nos papilles pour le détecter. Selon Dennett, c’est en quelque sorte parce que nous aimons le miel qu’il a un goût que nous trouvons délicieux. Inversion du raisonnement.
- La séquence « sexy » dès 3:50 vaut son pesant de cacahuètes : que signifie « sexy » pour un chimpanzé ? Si nous ne trouvions pas sexy nos partenaires sexuel(le)s, nous ne nous reproduirions pas. Etre sexy est une conséquence, pas une qualité absolue. Inversion.
- Pourquoi les bébés sont-ils mignons ? C’est une conséquence obligatoire de l’évolution que nous les trouvions jolis, sinon nous les abandonnerions ou au mieux ne changerions pas leurs couches. Inversion encore.
- Pourquoi apprécions nous les blagues ? Selon Dennett et d’autres auteurs travaillant sur ce sujet, l’humour est un système neural qui récompense le travail intellectuel. Il n’y a rien de fondamentalement marrant : c’est faisant fonctionner notre cerveau que nous trouvons certaines choses drôles. La présentation de Dennett en est un excellent exemple.
Liens:
- Daniel Dennett « Show me the Science« , New York Times, 28 août 2005
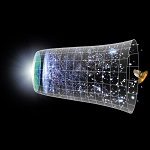




5 commentaires sur “Pourquoi on aime le joli, le sexy, le sucré et le drôle”
Wow : beaucoup de conférences du TED sont désormais sous-titrées en plusieurs langues dont le français : et c’est le cas de celle-ci ici : http://www.ted.com/talks/dan_dennett_cute_sexy_sweet_funny.html
très intéressant, merci !
je ne commente que rarement mais je lis tout vos articles avec attention.
juste pour être le pénible-de-service « pourquoi aime-t-on » plutôt que « pourquoi on aime »)
merci pour les fleurs. D’accord avec votre remarque si c’était une question, et dans ce cas il eut fallu un point d’interrogation final, mais là je le voyais plutôt comme une réponse…
Excellent! J’aurais quand même deux remarques:
1) La dernière partie sur l’humour me paraît un peu courte: une récompense du travail de l’esprit? Perso, je ne ris jamais quand je finis un sudoku (sauf quand je me rends compte que j’ai tout faux). L’autre hypothèse, plus classique, est que l’humour est nécessaire en tant que liant social, tout comme le sens de l’harmonie musicale ou celui du rythme.
2) Après réflexion, la démonstration de Dennet me semble parfaitement correcte tant qu’il s’en tient aux stimulus primaires (les bébés, les femmes, le miel), mais je ne vois pas où serait l’inversion dès qu’on touche à ce qu’il appelle les « superstimulus ». Car en fin de compte, si on aime le gâteau, c’est bien parce qu’il est sucré (et qu’on a appris à aimer le miel etc.) et pas l’inverse.
Idem, si on aime les peluches, c’est bien parce qu’ils nous rappellent les bébés et c’est cette propriété qu’on appelle « être mignon ». Donc oui, si on aime les petits chatons c’est parce qu’ils sont « mignons »…
C’est marrant, quand j’ai vu la vidéo sur mon netvibes, j’ai cru que Dennet était Darwin himself. Cultiverait-il la ressemblance ? Les évolutionnistes barbus ont-ils un complexe d’Oedipe scientifique ?